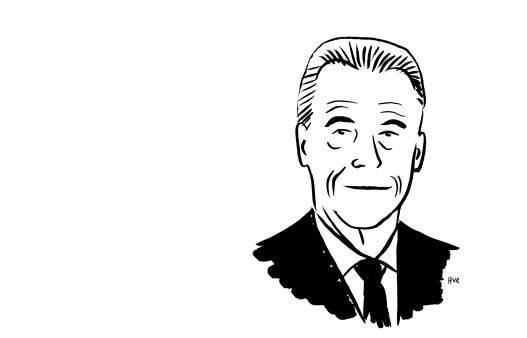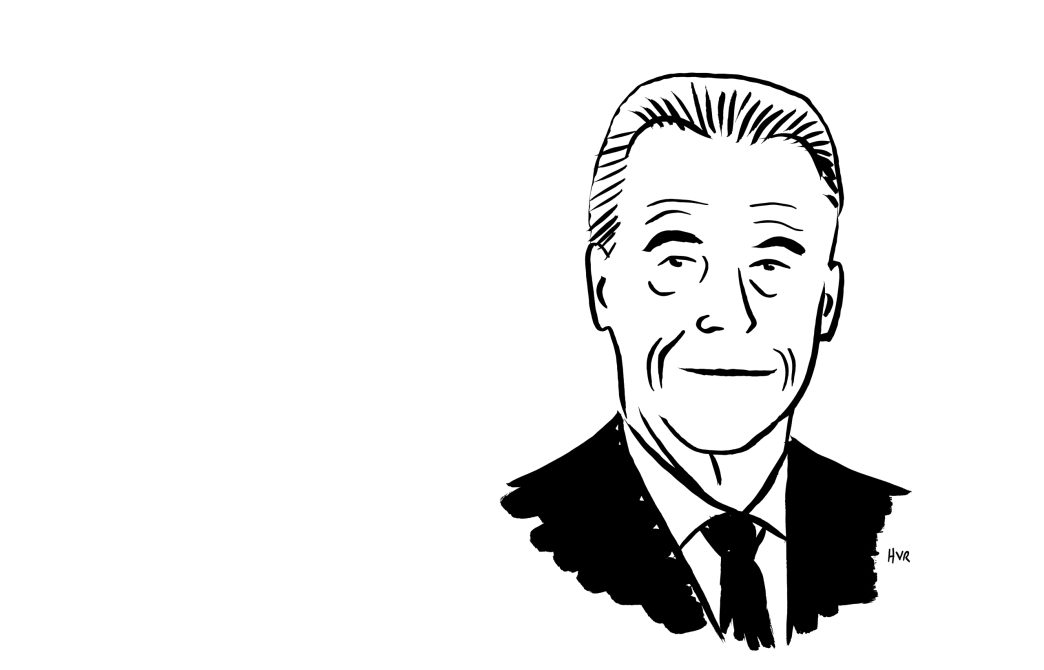Ancien Ambassadeur de Suisse, ancien Président de la Fondation pour l’Histoire des Suisses dans le monde.
Guillaume de Sardes : Depuis son élection, le Président Donald Trump cherche à résoudre le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine depuis 2014. Les négociations semblent avancer rapidement. Après un long appel téléphonique entre le Président des États-Unis et celui de Fédération de Russie, une première rencontre de haut niveau a eu lieu à Riyad entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov. C’est dans la capitale de l’Arabie Saoudite qu’elles se poursuivent, loin de l’Europe où se déroule pourtant le conflit. Comment interprétez-vous ce paradoxe ?
Rodolphe Imhoof : Il faut d’abord clarifier de quel type de négociations nous parlons. Je me pose la question : est-ce que M. Donald Trump cherche vraiment à résoudre le conflit, ou simplement à tirer un bénéfice politique ou économique de la cessation des hostilités ? Résoudre un conflit, ce n’est pas simplement mettre fin à la guerre. Il s’agit d’un processus beaucoup plus profond, impliquant la reconstruction, la révision des relations entre les nations et la réconciliation des parties prenantes. Le but de M. Trump me semble plutôt d’obtenir le label de « homme de paix ». Il va au plus simple, au plus rapide, sans chercher à réunir les conditions qui pourraient permettre aux nations belligérantes de vivre côte à côte sur le long terme. Nous assistons à une tractation politique. M. Trump semble vouloir contenter la Russie au détriment des Ukrainiens et des Européens. Pour cela, il est prêt à imposer la paix en cessant de fournir des armes à l’Ukraine. Or une paix imposée n’est jamais une paix juste et durable.
Vous suggérez que M. Trump pourrait aboutir à un cessez-le-feu mais pas à un véritable traité de paix, c’est bien cela ?
Exactement. Un cessez-le-feu peut être imposé, notamment par des puissances qui le garantissent, mais cela ne signifie pas qu’un traité de paix soit signé. Pensez au cas coréen : nous avons effectivement une cessation des hostilités entre Coréens du nord et du sud, mais il n’y a toujours pas de traité de paix, même après des décennies. Les deux pays n’entretiennent guère de rapports amicaux ou de bon voisinage, qu’ils soient politiques ou commerciaux. Ce type de situation, où la guerre s’arrête sans qu’un accord véritable ne soit signé, crée une coupure entre les États et les peuples qui peut durer longtemps. Dans ces conditions, la guerre à davantage de risques de reprendre.
Pourriez-vous nous rappeler quelle a été et est la position de la Suisse vis-à-vis du conflit qui oppose l’Ukraine, soutenue par les Occidentaux et leurs alliés, à la Russie ?
La Suisse défend une politique étrangère fondée sur le respect du droit international. Elle rappelle constamment que la guerre, telle que la mène la Russie, viole la Charte de l’ONU. Il est important de comprendre que la Suisse, en tant qu’État neutre, n’est impliquée dans aucune alliances militaires – elle n’est donc pas membre de l’OTAN – mais cela ne l’empêche pas d’œuvrer pour la préservation du droit international. Une des missions essentielles que s’assigne la Suisse est la défense des principes de non-agression et de protection des populations civiles.
En juin 2024, la Suisse a organisé une Conférence pour la paix en Ukraine à laquelle la Russie n’était pas conviée. Cela vous parait-il avoir été une erreur expliquant qu’aujourd’hui les discussions entre Américain et Russe se tiennent en Arabie Saoudite plutôt qu’en Suisse ?
Vous parlez de la conférence qui s’est tenue au Bürgenstock à laquelle les Russes, dès le début, ont dit qu’ils n’assisteraient pas. Dans ces conditions, la Suisse a fait le choix de ne pas les inviter formellement. Dès lors que la Russie n’était pas présente, il ne pouvait s’agir d’une conférence de paix au sens strict du terme. Les discussions ont plutôt porté sur la voie à suivre, le cadre et les conditions futures de la reconstruction de l’Ukraine. Symétriquement, des négociations entre les États-Unis et la Russie qui excluent l’Ukraine, n’ont pas plus de chance d’aboutir à une paix juste et durable. Il faut que tous se parlent. Seul un dialogue ouvert qui touche à la sécurité, à la coopération, qui élabore des mesures qui sont de nature à développer la compréhension et la confiance réciproques peut conduire à la paix. On l’a bien vu durant la guerre froide à travers le rôle qu’a joué la CSCE, qui était une instance multilatérale de dialogue et de négociation entre les blocs de l’Est et de l’Ouest.
Dans le prolongement de ma question précédente, pensez-vous que l’esprit de Constitution fédérale suisse qui prévoit que le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale doivent veiller à préserver la neutralité a été respecté à cette occasion ?
Je rappelle que la neutralité n’est pas un but en soi, elle est un moyen. Elle est le principal instrument de la politique étrangère suisse. Nous sommes un petit pays enclavé dans la culture européenne, ce qui ne nous empêche pas, comme chaque pays le fait, de défendre nos propres intérêts tout en restant en dehors des conflits. La neutralité suisse n’est pas une position passive, elle est active. Cela signifie que la Suisse peut jouer un rôle positif dans la résolution des conflits en offrant son territoire comme espace de dialogue et en facilitant des discussions entre les belligérants.
En ce moment, même si les négociations entre Russes et Américains autour de l’Ukraine se déroulent ailleurs, cela n’empêche pas que ces mêmes Russes et Américains se voient en Suisse pour discuter d’autres questions. La guerre en Ukraine n’est qu’un aspect parmi d’autres de leurs relations bilatérales.
D’une manière générale, pensez-vous que la politique de neutralité suisse doit être défendue et préservée ou bien qu’elle devrait être abandonnée ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Pour préciser le contexte de cette question, certains ont pu dire que la Suisse aurait dû s’engager plus complètement aux côtés de l’Union Européenne à l’occasion de cette guerre.
La neutralité est un concept fluctuant. La politique suisse peut changer au cours du temps. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’approche suisse était différente de celle d’aujourd’hui. Ce qui me semble important, au-delà des fluctuations imposées par le temps et le contexte politique, est que la neutralité, pour être crédible, ne peut se permettre d’être faible. Elle doit pouvoir être défendue. Aujourd’hui, le Parlement souhaiterait augmenter le budget de la défense de 2 milliards de francs suisse. C’est énorme, mais cela me semble justifié vu les circonstances.
La neutralité de l’Ukraine vous paraît-elle pouvoir être une solution au conflit ?
C’est une question complexe. La neutralité est un principe juridique qui suppose que d’un côté l’État neutre ne s’implique pas dans les conflits, mais que de l’autre il puisse défendre cette neutralité par les armes, si nécessaire. De ce point de vue, la demande Russe d’une Ukraine neutre et désarmée ne me semble pas respecter l’esprit de la neutralité. Pour que la neutralité soit effective et crédible, il faut que la sécurité de l’Etat en question soit garantie.