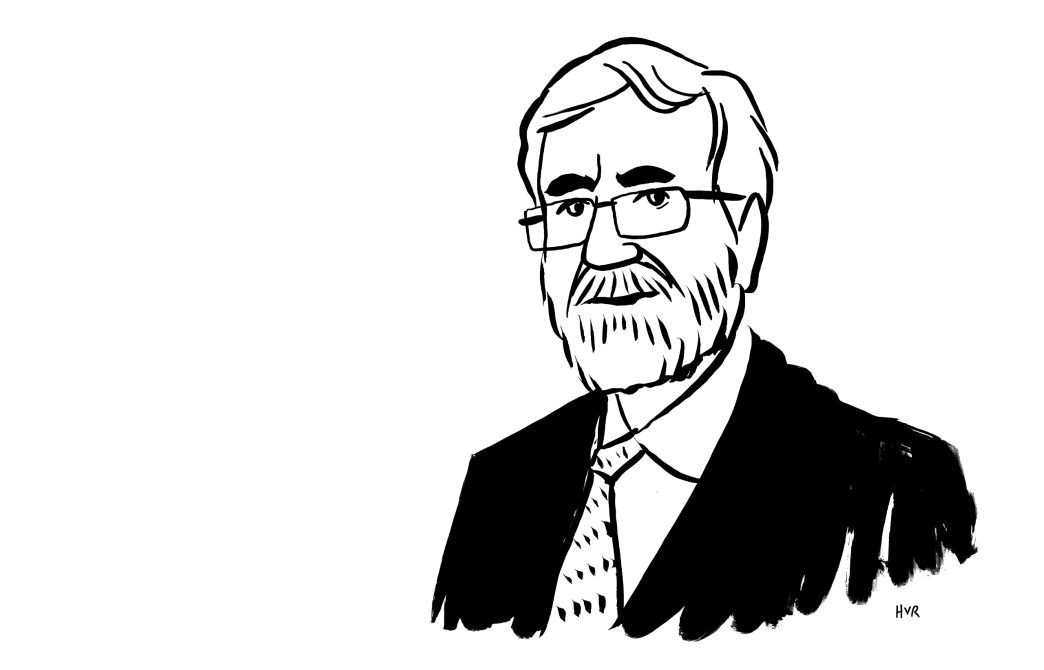Jean de Gliniasty est un diplomate français. Il a notamment été Ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, pays sur lequel il a écrit de nombreux articles et essais.
Guillaume de Sardes : Vous êtes un des meilleurs connaisseurs français de la Russie à laquelle vous avez consacré plusieurs livres, dont Géopolitique de la Russie qui vient d’être republié dans une édition mise à jour. Dans cet essai synthétique ordonné autour de quarante questions vous évoquez une « nostalgie impériale » de la Russie. Qu’entendez-vous par là ?
Jean de Gliniasty : La Russie a toujours fonctionné depuis Ivan III comme un empire autour du noyau dur « russe » mais en agrégeant les peuples conquis ou dominés. Un empire intègre voire promeut ceux qui acceptent son autorité et réprime ceux qui ne l’acceptent pas. La Russie soviétique n’a pas failli à la règle. La Russie post-soviétique a hésité entre diverses formules, mondialisation libérale, État Nation Russe ou système de type impérial, mais la pesanteur du modèle historique se fait sentir. La « nostalgie impériale » c’est celle de la grandeur du pays et d’un système qui, au moins dans l’esprit des russes, ne marchait pas si mal.
Vous affirmez plus loin que Poutine « ne cherche pas à revenir au passé »
Poutine sait bien que la puissance de son pays ne lui permet plus de recréer l’Union Soviétique ou l’empire russe. Mais il estime que l‘Histoire et le rapport de force actuel devrait lui permettre de rétablir au moins une sorte de zone d’influence, selon des formes variables, dans son « étranger proche » , c’est-à-dire dans les anciennes républiques soviétiques (à l’exception des pays baltes dont l’histoire est particulière , la culture reconnue comme étrangère, et surtout qui ont pris de vitesse la Russie en adhérant vite à l’OTAN et à l’Union Européenne). La caractéristique essentielle de cette zone d’influence est, dans l’esprit de Moscou, l’absence d’intégration dans l’OTAN. C’est une constante de la diplomatie russe depuis plus de vingt ans.
Vous consacrez des pages intéressantes aux rapports triangulaires Russie-Chine-États-Unis. Comment les résumeriez-vous ? Quels en sont les principaux enjeux pour chaque pays ?
Les Etats-Unis de Kissinger avaient su être le sommet d’un triangle Washington- Moscou Pékin. La chute de l’URSS avait brouillé le paysage tandis que la Chine montait en puissance. La Russie ployant sous les sanctions occidentales après l‘invasion de l’Ukraine, dépend maintenant de la Chine, peut-être un peu trop à son goût. Trump tente visiblement de redevenir le sommet du triangle. Mais la montée rapide d’autres puissances à vocation globale (Inde, Brésil, Indonésie, peut-être Iran…) risque de rendre cette vision obsolète avec l’apparition d’un monde multipolaire autrement plus complexe.
Vous résumez ainsi les rapports économiques sino-russes : « le premier exportateur d’hydrocarbures au monde vend son gaz et son pétrole au premier importateur mondial d’énergie et achète ses produits manufacturés. » Peut-on parler d’interdépendance ou bien la relation économique entre les deux pays vous paraît-elle déséquilibrée ?
Toute relation où l’un fournit des matières premières et l’autre des produits ouvrés est déséquilibrée économiquement et à terme politiquement. La Russie s’efforce de remédier à ses faiblesses relatives en matière industrielle et dans le domaine des nouvelles technologies de l’information. Les sanctions l’obligent, parfois avec succès, à développer des politiques de substitution aux importations occidentales par la production locale ou par des importations de pays tiers.. La guerre en Ukraine a plutôt accru sa dépendance à la Chine et à d’autres pays qui l’aident à contourner les sanctions. Mais en général la production industrielle russe a crû et le bilan de l’économie de guerre russe ne pourra être établi que plus tard.
Vous écrivez que la Chine n’est plus guère intéressée par le projet de gazoduc Force de Sibérie 2, qui permettrait d’augmenter les livraisons de gaz de 50 milliards de m3 par an. Pourriez-vous éclairer la position chinoise ?
La Chine y sera plus intéressée quand elle en aura vraiment besoin mais sa croissance est actuellement plus faible et elle se fait prier.
Comment pensez-vous que les rapports économiques entre l’Union européenne et la Russie vont évoluer ? Vous qualifier leur recule de « mouvement irréversible ». Mais si les États-Unis lèvent leurs sanctions et relancent le commerce avec la Russie, l’Union européenne ne devra-t-elle pas suivre ? Le patronat allemand, en particulier, semble désireux de retrouver un accès à l’énergie russe bon marché.
Les Russes réfléchissent à la question. A ce stade ils estiment que les entreprises qui sont restées discrètement sous une forme ou une autre sur le marché russe ou qui se sont mises en position d’attente verront leur retour facilité… Celles qui sont parties brutalement paieront un prix exorbitant pour revenir. Mais dans l’hypothèse incertaine d’un règlement de la crise ukrainienne et d’un retour en force des entreprises américaines, les logiques économiques reprendront vite le dessus, pour peu que les gouvernements européens ne s’y opposent pas, ce qui paraît probable. Ce sera aussi le cas pour l’énergie mais le marché a beaucoup évolué, les fournisseurs ont changé, et l’on ne reviendra pas à la situation de dépendance observée avant la guerre en Allemagne et dans d’autres pays européens. Le développement des énergies renouvelables et le retour du nucléaire ont changé la donne. Il reste qu’un retour du gaz russe ferait baisser le prix de l’énergie qui pénalise actuellement les entreprises européennes.
Dans ses rapports avec la Russie, l’Union européenne campe sur ses positions. Elle ne semble pas penser devoir tenir compte du renversement de la politique américaine. Le cessez-le-feu proposé par M. Trump a ainsi été immédiatement interprété comme une offre « à prendre ou à laisser » suscitant l’espoir que, si cette offre était déclinée par la Russie, alors « les États-Unis rejoindraient la guerre » – pour reprendre les mots du Premier ministre britannique Keir Starmer. Dans le contexte de la réorientation de la politique américaine et des positions clairement exprimées par M. Trump et de son entourage, cette idée pouvait semblée chimérique. Elle a d’ailleurs été rapidement démentie par les faits, puisque M. Trump vient de déclarer avoir eu « une excellente conversation » avec M. Poutine alors même que ce dernier n’a accepté qu’un cessez-le-feu limité aux seules infrastructures énergétiques. Comment expliquer ce manque de lucidité de la part des Européens ?
Les Etats-Unis se soucient peu du sort de l’Ukraine et veulent prendre leurs distances avec l’Europe. Trump souhaite se rapprocher de la Russie même si c’est sans tenir compte du point de vue européen et au détriment de l’Ukraine de Zelensky. A l’Europe de gérer ses intérêts et c’est pour elle une chance historique de prendre ses responsabilités en matière de défense. Quant à la guerre en Ukraine pour l’instant elle semble accorder la priorité au renforcement de la capacité ukrainienne à négocier dans de bonnes conditions même en cas de « lâchage » des américains. Mais on ne reviendra pas sur la volonté, maintenant largement partagée, d’une plus grande autonomie stratégique de l’Union Européenne même si la position des européens sur la question ukrainienne peut varier en fonction d’une négociation à laquelle elle ne participe pas directement.
Dans une récente interview, Jeffrey Sachs juge qu’en Europe « la rhétorique est incroyablement enflammée et souvent obtuse ». « Avoir tort tout le temps – dit-il –, comme les Britanniques et les Français, n’est pas une négociation habile, une politique habile ou un marchandage habile. » Vous-même qui avez été diplomate comment jugez-vous l’action de MM. Starmer et Macron ? Leurs buts vous paraissent-ils clairs ? Ont-ils une chance de les atteindre ?
Pour l’instant la volonté de certains pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, de continuer à aider l’Ukraine et de fournir des garanties de sécurité sous forme de contingents, sert le projet de Trump qui a besoin aussi d’exercer une certaine pression sur Poutine. Mais si le processus de paix, dont les européens ne font pas partie , progressait je doute que ceux-ci s’opposent longtemps à un accord agréé par Washington, Moscou et Kiev ( même si les ukrainiens risquent de se faire forcer la main).