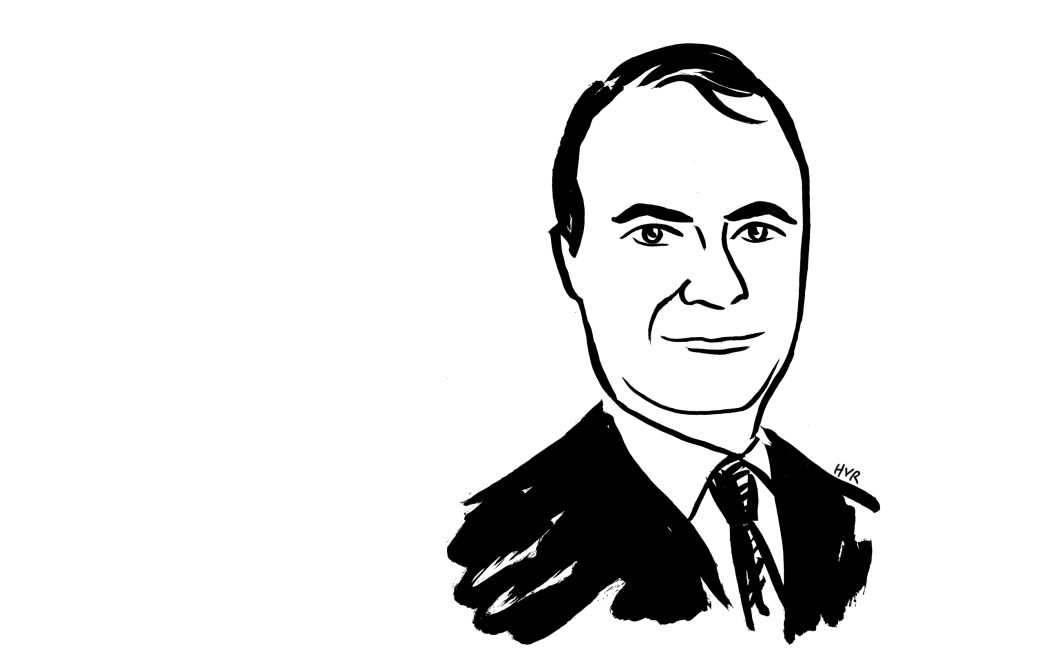Nicolas Ramseier est un homme politique suisse, ancien président du PLR Ville de Genève et ancien collaborateur de la section politique et diplomatique de l’Ambassade de Suisse à Belgrade. Il dirige aujourd’hui le Centre de Genève pour la Neutralité, où il promeut une conception moderne de la neutralité suisse.
Maria Kuznetsova : Beaucoup de nos lecteurs associent la Suisse à la neutralité, mais peu comprennent comment ce principe se traduit concrètement dans les institutions. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le travail du Centre de Genève pour la Neutralité (GCN) ? Quelle est sa mission, quelles tâches accomplit-il et comment transforme-t-il la neutralité d’un concept en un outil pratique ?
Nicolas Ramseier : Il est essentiel de souligner, en introduction, que la neutralité suisse a initialement été imposée de l’extérieur. Selon certains, ses premières racines remontent à plus de 400 ans, après la défaite de Marignano en 1515 face à la France en Italie du Nord, qui conduit la Confédération à renoncer durablement aux guerres d’expansion. Pour d’autres, elle date surtout du Congrès de Vienne en 1815, lorsque les grandes puissances ont voulu créer une zone tampon entre la France et le reste de l’Europe.
Avec le temps, nous avons compris qu’elle était aussi indispensable à l’intérieur du pays, parce que la Suisse réunit plusieurs langues, religions et intérêts économiques, parfois divergents. La neutralité a joué un rôle important pour limiter les fractures internes, en complément du fédéralisme et du compromis politique. On l’a vu, par exemple, lorsque l’armée suisse a empêché des Tessinois de franchir la frontière pour soutenir les soulèvements de Milan, ou encore lors des tensions profondes de la Première Guerre mondiale entre élites germanophiles et populations francophones. La presse était d’ailleurs profondément polarisée et l’armée elle-même divisée, mais la neutralité a fourni un terrain commun permettant d’éviter un éclatement politique plus grave.
Ce principe nous a ensuite donné une force diplomatique : de nombreux accords signés à Genève, l’installation des Nations unies, et le développement de la Croix-Rouge, dont la neutralité est encore plus stricte que celle du gouvernement suisse.
Pourquoi le GCN ? Parce que le monde, et l’Europe avec lui, ont profondément changé ces dernières années. La Suisse que j’ai retrouvée à mon retour après mes brèves années à l’étranger se retrouve ballotée et ne sait plus très bien sur quel pied danser dans sa relation avec l’Union européenne, avec l’OTAN et avec d’autres partenaires. J’ai voulu donc créer un think tank ouvert et démocratique pour remettre au centre du débat les grandes questions de nos relations avec le monde, dont évidemment la neutralité, afin de réfléchir à ses fondements et d’imaginer des solutions solides pour les décennies à venir.
Nous analysons la neutralité dans toutes ses formes, non seulement politique et diplomatique, mais aussi économique et numérique, car nous pensons que nous ne pouvons être neutres que si nous gardons un certain niveau d’indépendance et de souveraineté. Sur ce point, j’aime donner le cas du Liban. Le Liban pourrait pleinement bénéficier d’une posture neutre, mais il n’y parvient pas, car il se retrouve systématiquement écrasé entre plusieurs forces intérieures, elles-mêmes dépendantes d’acteurs étrangers qui exercent une influence déterminante sur le pays.
Et c’est en partie ce que la Suisse a connu lors de la Première Guerre mondiale. Les généraux germanophones étaient plutôt pro-Allemagne et les francophones davantage pro-France. Pour être neutre, il faut donc conserver un niveau suffisant d’indépendance et une véritable souveraineté. Et, cela vaut également pour le domaine technologique. C’est pour cette raison que nous avons défini un axe de réflexion consacré au numérique.
Notre mission est donc aussi de transformer la neutralité en un outil pratique pour l’avenir de la Suisse.
Comment votre parcours professionnel (ingénieur/diplômé de l’EPFL, secteur bancaire et privé, travail au sein du département des affaires étrangères de la Suisse, politique municipale à Genève) a-t-il façonné votre vision de la neutralité ? Quels aspects de cette expérience se sont avérés importants pour le GCN ?
Je ne m’étais jamais vraiment demandé si mon parcours influençait ma vision de la neutralité, mais la réponse est évidemment oui. Ma formation scientifique m’a donné l’habitude de poser les choses à plat, analyser et chercher des solutions, et cette approche se retrouve naturellement dans l’idée de créer un think tank dédié à la neutralité.
Le fait d’avoir beaucoup voyagé et vécu à l’étranger a aussi joué un rôle. J’ai toujours eu une curiosité profonde pour les autres cultures, l’idée qu’il existe plusieurs façons de voir le monde et qu’il faut écouter avant de juger. C’est très compatible avec la neutralité : rester fidèle à ses valeurs tout en cherchant à comprendre l’autre.
Mon passage au Département fédéral des affaires étrangères a encore renforcé cette conviction. La neutralité et la confiance associée au nom de la Suisse ouvrent des portes. Dans les Balkans, je pouvais parler aussi bien avec les Serbes qu’avec les Croates, les Bosniaques ou les Kosovars et être entendu par tous. C’est un avantage concret dans le travail diplomatique.
Enfin, mon expérience bancaire m’a montré à quel point la confiance est un capital essentiel. Une grande partie de la finance suisse repose sur la gestion transfrontalière, et cela n’est possible que si l’on inspire confiance. Tout cela a évidemment façonné mon intérêt pour la neutralité et explique pourquoi je m’y consacre aujourd’hui au sein du GCN.
Vous dites que la neutralité peut être représentée comme un bâtiment de trois étages : la neutralité juridique selon la Convention de La Haye ; la perception de la neutralité, c’est-à-dire la façon dont les autres États voient et interprètent votre position ; et enfin, la neutralité totale. Et pour la Suisse, comme vous le soulignez, « le véritable enjeu se situe au deuxième étage : la perception et la confiance ». Si la base juridique est consacrée par le droit international et qu’un isolement total est impossible pour la Suisse, quels instruments concrets permettent de gérer précisément la perception de la neutralité ?
Vous touchez là au point central. Tous les avantages de la neutralité : notre rôle diplomatique, notre capacité de tisser des liens économiques privilégiés, la confiance qu’on nous accorde — reposent fortement sur la perception. La base juridique est solidement garantie, et l’isolement total serait non seulement impossible mais catastrophique pour la Suisse, qui dépend largement de ses échanges extérieurs. Tout se joue donc, à mon avis,au niveau de la réputation et de la confiance.
C’est précisément là que les difficultés apparaissent. En 2022, la reprise partielle des sanctions a été perçue comme une rupture, notamment par la Russie, mais aussi par une partie du monde asiatique. On peut comprendre cette réaction. Dans notre cas, la Suisse s’est retrouvée dans une situation extrêmement contrainte. Selon ce qui circulait à Berne, les gouvernements européens et américain envisageaient de sanctionner des grandes entreprises suisses si nous ne les suivions pas dans ces sanctions. Le Conseil fédéral s’est donc retrouvé dos au mur. Ce que je regrette surtout, c’est l’absence de débat public ici, alors que la Suisse a toujours traité les grandes questions de manière transparente. Si ces pressions étaient réelles, le pays aurait pu comprendre. Si elles ne l’étaient pas, cela pose un problème démocratique beaucoup plus sérieux.
La perception dépend aussi de notre propre comportement à l’extérieur. Nous ne pouvons pas, d’un côté, vouloir accueillir une rencontre entre les présidents américain et russe, et de l’autre, nous rendre à Kiev pour y tenir des déclarations très publiques aux côtés du président ukrainien. Sur le plan humain, il est évident que nous sommes solidaires du peuple ukrainien, qui souffre terriblement de cette guerre, et notre effort et action humanitaire doivent être présents mais discrète. Une guerre reste toujours l’expression la plus tragique de la condition humaine. Néanmoins, si nous voulons rester un médiateur crédible et offrir nos bons offices, nous devons veiller à ne pas nous afficher trop ouvertement avec l’une des parties.
Malgré tout, j’observe un élément positif. Dans les discussions privées, beaucoup de politiques et diplomates étrangers, y compris russes, chinois ou indiens, comprennent la position difficile dans laquelle la Suisse s’est retrouvée et continuent de nous considérer comme un acteur fiable. Cela montre que notre capital d’expertise et de neutralité n’est pas détruit, mais qu’il doit être préservé activement, avec cohérence et transparence.
Vous avez mentionné qu’en 2022 la Suisse s’est jointe à une partie des sanctions, ce qui est interprété comme un « écart » par rapport à sa neutralité. Où se situe votre ligne rouge personnelle en matière de participation aux régimes de sanctions afin de ne pas détruire le « niveau de perception » ?
Je préfère éviter de parler de « ligne rouge » au sens strict. En politique internationale, lorsqu’un dirigeant fixe une ligne rouge et qu’elle est franchie, soit il doit intervenir, ce qui peut être grave, soit il perd sa crédibilité. La crédibilité de la Suisse repose d’abord sur des éléments objectifs de longue durée. Nous n’avons jamais mené de guerre offensive, nous respectons systématiquement le droit international, nous sommes associés à l’aide humanitaire et nous avons une tradition de bons offices reconnue. C’est cette image qui doit être préservée.
Si je devais quand même définir ma propre limite, je dirais ceci : rester aussi neutre, impartial et respecté que possible tant que nos intérêts vitaux ne sont pas directement menacés. Et j’ajouterais un point essentiel : plus la Suisse a de partenaires économiques diversifiés, plus elle est indépendante et souveraine. Si nos relations sont équilibrées entre l’Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique du Sud, il devient beaucoup plus difficile pour quiconque de nous imposer un comportement ou des sanctions. La neutralité se protège aussi par cette diversification.
Aujourd’hui, le monde revient en fait à la logique des blocs. Les pays neutres se retrouvent dans une situation où ils n’ont pas le choix. À votre avis, un État peut-il vraiment se permettre, au XXIe siècle, de ne s’allier à aucun bloc ?
J’espère que les États pourront encore rester en dehors des blocs, parce que la logique des blocs est par nature confrontationnelle. L’histoire montre que lorsque deux blocs se touchent, géographiquement ou dans leurs intérêts, cela débouche presque toujours sur des conflits, et les premières victimes sont les populations. Aujourd’hui, on voit clairement cette polarisation : l’Europe sommée de se positionner face à la Chine, la Russie et la Chine qui se rapprochent avec l’Iran et la Corée du Nord, et l’émergence discutable du concept de Global South, qui regroupe pourtant des pays très différents.
Il est vrai qu’il y a de moins en moins d’États neutres : la Finlande et la Suède ont rejoint l’OTAN, l’Autriche débat de son avenir, et en Suisse la question reste ouverte. Être neutre demande désormais beaucoup plus de courage et surtout un certain niveau d’indépendance.
Je ne sais pas si la neutralité survivra, mais je suis convaincu qu’elle reste indispensable. Les pays neutres jouent le rôle de zones tampons, de lieux de dialogue, un peu comme le cartilage entre les os. Sans eux, la friction devient un choc. Peut-être seront-ils moins nombreux, mais leur utilité, elle, ne disparaîtra pas.